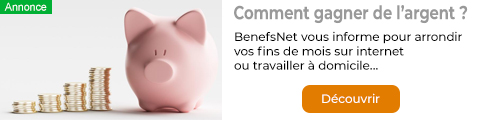| Auteur |
Message |
Brachou
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 120
Localisation: 64

|
 Posté le:
16 Nov 2008, 21:56 Posté le:
16 Nov 2008, 21:56 |
  |
salut!
c'est vrai que ca send pas très bon.
 |
|
|
  |
 |
brembored
Référent ENGINS

Sexe: 
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le:
17 Nov 2008, 10:01 Posté le:
17 Nov 2008, 10:01 |
  |
Merci Briga, j'ai donc ma réponse.
ça ressemble à la création du BMPM finalement...
un grave incident, des SP locaux dépassés, et un renfort militaire. |
_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
  |
 |
ghysmo64
Passionné

Inscrit le: 09 Mar 2008
Messages: 332

|
 Posté le:
19 Nov 2008, 21:17 Posté le:
19 Nov 2008, 21:17 |
  |
Salut a tous
J'ai été SPV dans les PA, et j'ai été formé a artix par les sp de Paris au CFAPSE et CFAPSR. Le détachement et bien présent à Artix et intervient en complément des moyens des usines. A la belle époque ils armaient une AR ou un VSAV dans uen maison situé contre l'usine. Et ils faisaient aussi la tournée quotidienne des puits. Cependant ils avaient une autre tache très spécifique et qu'ils ont toujours. Ils possèdent deux véhicules style VTU ou se trouve un stock impressionnant de brancards pliables militaire et un stock de pastilles d'iode correspondant au nombre d'habitant de la zone du bassin de lacq qu'ils doivent distribuer si une intervention de grande anvergure chimique devait arriver. Ils distriburaient les pastilles d'iode et les brancard je vous laisse imaginer hélas à quoi cela pourrait servir. Je n' ai aucune idée à savoir pourquoi c'est aux militaires de faire cela ( mis à part que quand ca craint peut être que nos politiques préfèrent envoyer des militaires comme cela il y a moins de compte à rendre puisque les victimes seront des militaires ce n'est que ma pensée et en aucun cas une source sure ) Enfin si obligation de distribuer très vite ils sonne le rappel et il a 50 militaires en 2 minutes puisques la totalités des SP d'artix habitent en face de la caserne à 30 mètres. |
_________________
ce que pense un jour une personne, un autre un jour sera capable de le réaliser |
|
  |
 |
Brachou
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 120
Localisation: 64

|
 Posté le:
19 Nov 2008, 22:13 Posté le:
19 Nov 2008, 22:13 |
  |
Salut Ghysmo64!
J'aurais deux petites questions:
pourquoi de l'iode? je sais qu'on s'en sert en cas de risque nucléaire pour saturer la thyroide, mais par rapport au risque chimique?
ensuite tu viens d'où dans les pyrénées atlantiques?
Merci d'avance tchu
 |
|
|
  |
 |
Forny
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 1511
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)

|
 Posté le:
19 Nov 2008, 22:50 Posté le:
19 Nov 2008, 22:50 |
  |
| ghysmo64 a écrit: | Salut a tous
J'ai été SPV dans les PA, et j'ai été formé a artix par les sp de Paris au CFAPSE et CFAPSR. Le détachement et bien présent à Artix et intervient en complément des moyens des usines. A la belle époque ils armaient une AR ou un VSAV dans uen maison situé contre l'usine. Et ils faisaient aussi la tournée quotidienne des puits. Cependant ils avaient une autre tache très spécifique et qu'ils ont toujours. Ils possèdent deux véhicules style VTU ou se trouve un stock impressionnant de brancards pliables militaire et un stock de pastilles d'iode correspondant au nombre d'habitant de la zone du bassin de lacq qu'ils doivent distribuer si une intervention de grande anvergure chimique devait arriver. Ils distriburaient les pastilles d'iode et les brancard je vous laisse imaginer hélas à quoi cela pourrait servir. Je n' ai aucune idée à savoir pourquoi c'est aux militaires de faire cela ( mis à part que quand ca craint peut être que nos politiques préfèrent envoyer des militaires comme cela il y a moins de compte à rendre puisque les victimes seront des militaires ce n'est que ma pensée et en aucun cas une source sure ) Enfin si obligation de distribuer très vite ils sonne le rappel et il a 50 militaires en 2 minutes puisques la totalités des SP d'artix habitent en face de la caserne à 30 mètres. |
Alors oui, il y a quelques années, il y avait un VSAB equipé en AR avec un médecin BSPP. Ce vehicule décalé comme vehicule SMUR pour le compte du samu 64. Epoque révolue, et j'ai activement participé à la ventilation et au desengagement de l'unité pour cet agrés.
Il n'y a pas de pastille d'iode à distribuer sur la zone du bassin de lacq, le risque etant l'Hydrogène sulfuré issue de la tio_chimie.
Par contre, un stock de cagoule d'evacuation, adulte, enfant et de confin servent pour evacuation d'urgence des populations recensées sur la zone du bassin de Lacq ou se situe des puits d'extrations du gaz, soit une zone qui s'etend d'Orthez à Pau......
L'unité dispose d'un PMA, de brancard, d'un VPC et de bus pour l'evacuation des populations.
Il est exact que l'unité participe activement à la formation des SP du sdis en etant intégré à l'effectif de celui ci. Les formation faite à ARTIX, le sont pour le compte du SDIS.
briga |
|
|
  |
 |
Brachou
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 120
Localisation: 64

|
 Posté le:
19 Nov 2008, 22:55 Posté le:
19 Nov 2008, 22:55 |
  |
Salut brigadistador!
t'était pompier à Artix? A quelle période?
 |
|
|
  |
 |
Forny
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 1511
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)

|
 Posté le:
20 Nov 2008, 14:23 Posté le:
20 Nov 2008, 14:23 |
  |
| Brachou a écrit: | Salut brigadistador!
t'était pompier à Artix? A quelle période?
 |
1999-2003 |
|
|
  |
 |
sebdf68
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 04 Fév 2007
Messages: 372
Localisation: haut-rhin

|
 Posté le:
24 Nov 2008, 14:35 Posté le:
24 Nov 2008, 14:35 |
  |
On se demande ici pourquoi il s'agit de la brigade qui gere le site de lacq, on vient de nous répondre qu'il s'agit d'une raison historique suite à un incident qui aurait mal tournée et ou les sp locaux naurait pas assurer.
Je voudrais aussi préciser que lascq etait sans doute un des sites les plus sensible (surtout dans les années de son exploitation maximal 1970-80) de france, puisqu'il permettait à la france de trouver une indépendance gazière si chère à de gaulle.
Et la on voit que seule une unité militaire se doit de couvrir ce genre de site. Alors pourquoi, parce que les militaires en france n'ont pas de droit de grêve, ils sont corvéable à merci, et surtout soit disant ils sont "sur". Puisque ayant due passer par la phase recrutement du ministere de la défense.
voila la raison des gars de la brig à lacq, ils sont militaire. |
|
|
  |
 |
Brachou
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 120
Localisation: 64

|
 Posté le:
24 Nov 2008, 15:01 Posté le:
24 Nov 2008, 15:01 |
  |
é puis je vais peut être dire une c****rie mais peut être qu'a l'époque
le niveau de formation et de professionalisme était plus élevé
à la brigade?
non? |
|
|
  |
 |
Forny
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 1511
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)

|
 Posté le:
24 Nov 2008, 16:20 Posté le:
24 Nov 2008, 16:20 |
  |
Pour la petite histoire, le gisement fût decouvert entre deux guerres. A cette epoque, les technologies ne permettaient pas l'exploitation du site, etant donné la haute corosivité de l'H2S, et de ses dérivés. En effet, les tuyaux en acier ne tenaient pas la journée face à la corosion.
Il a fallu cacher ce site à nos envahisseurs d'outre-Rhin et ensuite faire des recherches pour permettre l'extration du gisement.
La guerre froide rajoute à l'histoire de ce champs pétrolifère, l'aspect économique, la crise de 70 n'est pas encore là....
Alors oui, à l'époque, les secours furent vite dépassés par l'événement, et l'aspect prevention des risques etaient inconnue de leur vocabulaire et loin d'être une culture.
La Brigade ne devait à l'époque que prendre des mesures preventionistes face à un nouveau risque chimique face au nombreux puits repartis entre Pau et Orthez (environ une centaine)
La départementalisation n'était pas non plus d'actualité, et les corps communaux se sont vite pris au jeux d'un corps constitué, efficace et bien intégré dans la population.
Ainsi, la bspp occupe le détachement depuis bientôt cinquante ans......
Le SDIS tient aujourd'hui les rênes de la prevention du risque chimique sur le departement, la BSPP est intégré comme le seraiot n'importe quel CS "civil" spécialisé.
briga |
|
|
  |
 |
Brachou
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 120
Localisation: 64

|
 Posté le:
24 Nov 2008, 16:28 Posté le:
24 Nov 2008, 16:28 |
  |
tu l'as vu où que le gisement a été découvert à entre les deux guerres? |
|
|
  |
 |
Forny
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 1511
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)

|
 Posté le:
24 Nov 2008, 18:46 Posté le:
24 Nov 2008, 18:46 |
  |
| Citation: | Bulletins de l’IHTP > Bulletin n°84 : Pétrole et gaz : Nouvelles perspectives et outils de recherche > Chronologie commentée sur l’histoire du pétrole et du gaz en France
--------------------------------------------------------------------------------
Chronologie commentée sur l’histoire du pétrole et du gaz en France
par Alain Beltran
1498
L’historien Jacob Wimpfeling écrit que, depuis longtemps, on se sert de bitume sur le site de Péchelbronn (« fontaine de poix », Alsace), sous le nom également de graisse, huile de pétrole. Ce liquide est utilisé comme lubrifiant mais aussi comme remède (blessures, lutte contre les insectes parasites).
1735
Un médecin d’origine grecque Evrini d’Evrinis entreprend l’exploitation du gisement. Il cède en 1740 ses droits au gentilhomme suisse de la Sablonnière qui crée la première société par actions, faisant de Péchelbronn une des plus anciennes sociétés pétrolières au monde. Puis Antoine Le Bel (originaire des environs de Toulouse) s’établit à Péchelbronn et, pendant plus d’un siècle, cette famille reste propriétaire de l’exploitation (jusqu’en 1889).
1745
Lettres patentes du roi Louis XV autorisant l’introduction dans le royaume des graisses, huiles, asphalte provenant de la manufacture de Péchelbronn.
1791
Loi du 28 juillet qui met fin au régime royal d’octroi des droits d’usage sur les mines.
1805
Napoléon Ier accorde à des particuliers l’exploitation des gisements de La Mure en Isère (l’activité pétrolière commence en fait en 1925).
1810
Loi du 21 avril sur l’exploitation des mines (valable pour plus d’un siècle).
Institution du Conseil général des Mines.
1832
A. F. Selligues étudie et distille des schistes bitumineux de la région d’Autun.
1851
Alexandre Deutsch de la Meurthe crée à Pantin la première usine de traitement d’huiles minérales en France.
1857
Les Lebel montent une première raffinerie à Péchelbronn.
1864
Loi douanière qui accorde l’entrée en franchise des huiles brutes (à l’inverse des huiles épurées).
1871
Loi du 8 juillet qui instaure un droit protecteur sur les produits raffinés importés (elle facilite en conséquence la construction de raffineries sur le sol national).
1877
Création de la société Les Fils de A. Deutsch de la Meurthe et Cie.
1892
Une société à capitaux anglais effectue des sondages en Algérie (différentes sociétés les poursuivent jusqu’au début des années 1920).
1893
La Vacuum Oil Cy ouvre un bureau de vente à Paris pour la commercialisation de ses huiles sous le nom de Vacuum française.
1902
La Standard Oil of New Jersey reprend en France la Bedford et Cie qui était spécialisée dans l’importation d’huiles sous le nom de Bedford Petroleum Co.
1903
Loi qui supprime la protection du raffinage en France (la plupart des raffineries françaises cessent en conséquence leur activité).
1904
La Compagnie industrielle des pétroles construit une raffinerie à Frontignan.
1910
Des groupes étrangers étudient la région du Tselfat au Maroc (affleurements connus depuis longtemps).
1914-1916
Système de contrats avec les importateurs qui s’engagent à fournir la France.
1917
Création du Comité général des pétroles pour la coordination des opérations.
Clemenceau envoie un télégramme pressant au président Wilson (« Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l’heure du suprême choc germanique, possède l’essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain ») pour que la France soit suffisamment approvisionnée en carburants.
1918
Monopole d’État sur les importations de pétrole.
Institution en août du Commissariat général aux essences et combustibles.
1919
Fin de la perpétuité et de la gratuité des concessions.
Pétroles et gaz naturel passent sous le régime de la loi minière.
L’État prend possession des mines, puits et installations industrielles de Merkwiller.
Indices positifs au Maroc dans la région de Tselfat-PetitJean.
1920
La France obtient les 25 % de la Deutsche Bank dans le capital de la Turkish Petroleum Company (traité de San Remo).
La Standard Oil of New Jersey crée l’Économique qui s’unit à la Pétroléenne (initialement Fenaille et Despeaux) la même année.
1921
Début d’exploitation dans l’Oranais algérien (Tliouanet).
Retour de la liberté de commerce de pétrole.
Création de la SAEM Péchelbronn.
Les fils d’Alexandre Deutsch de la Meurthe et le groupe Royal Dutch Shell s’associent dans la Société des pétroles Jupiter.
Création de la Société générale des huiles de pétrole par l’Anglo-Persian Oil Co, la maison Paix et Cie (raffinerie près de Douai depuis 1865), la société Georges Lesieur et ses fils, la société navale de l’Ouest, la maison Estrin et Cie (transports maritimes).
1923
Par lettre du 23 décembre, Raymond Poincaré charge Ernest Mercier, industriel de premier plan qui a déjà largement réorganisé le secteur électrique parisien, de prendre la présidence d’un syndicat d’études pétrolières devant mener à la constitution d’une compagnie pétrolière française.
1924
Petite découverte de pétrole dans l’Hérault (Gabian).
Création de la Compagnie française des pétroles qui obtient 23,75 % de la Turkish Petroleum Company.
1925
Création d’une école du pétrole rattachée à l’université de Strasbourg.
Création de l’Office national des combustibles liquides (ONCL) dont le directeur est Louis Pineau. L’ONCL doit aider à la constitution d’une solide industrie pétrolière en France (avec priorité à la prospection dans l’Empire).
La loi impose la constitution de stocks de réserve (un quart du tonnage de brut importé chaque année).
1926
C’est à Pechelbronn qu’est créée la première École des maîtres sondeurs, formant de nombreux spécialistes, appliquant leur savoir-faire un peu partout sur les champs pétroliers du monde.
1927
La prospection électrique réalisée sur le site de Pechelbronn par les frères Schlumberger est une première mondiale.
1928
Premières prospections au Congo.
Signature du « Red Line Agreement » entre l’Anglo-Iranian, la Royal Dutch Shell, la CFP, la Standard Oil of New Jersey, Socony Vacuum, Gulbenkian, soit les différents membres de la Turkish Petroleum Company. Les partenaires s’engagent à travailler à l’intérieur des anciennes frontières de l’empire turc (exception faite de l’Égypte et du Koweit).
Loi du 30 mars qui place les importations de pétrole brut, de ses dérivés et résidus sous l’autorité de l’État (autorisations spéciales à trois ou dix ans, contrat de devoir national…).
Création de la société des huiles Antar, filiale de Péchelbronn SAEM pour la distribution de lubrifiants.
Construction des raffineries de Petit-Couronne et Pauillac.
1929
Création de la Compagnie française de raffinage.
Création de l’Irak Petroleum Company à la place de la Turkish Petroleum Company.
Création de la société chérifienne des pétroles (Maroc).
Premières recherches au Gabon.
Standard Oil of New Jersey, Gulf Oil et Atlantic Refining s’associent dans la Société franco-américaine de raffinage pour construire la raffinerie de Port-Jérôme (mise en service en 1933).
Construction de la raffinerie de Berre l’Étang par une filiale de Saint-Gobain (la Compagnie des produits chimiques et raffineries de Berre).
La Société des raffineries de pétrole de la Gironde est créée et construit une raffinerie à Ambès (inaugurée en 1931).
1930
La Vacuum française et la Compagnie industrielle des pétroles construisent ensemble l’usine de lubrifiants de Notre-Dame de Gravenchon.
1931
Constitution d’une société d’exploration en Tunisie (autorités françaises locales, ONCL et CFP).
Mise en service de la raffinerie de Lavéra.
La Société des raffineries de pétrole de la Gironde signe avec le groupe américain Texas Cy un contrat d’approvisionnement en pétrole à long terme.
1933
Premier oléoduc (on disait pipeline) français entre Le Havre et une raffinerie de la Basse-Seine.
Construction de la raffinerie de Donges.
1934
La Société des raffineries de pétrole de la Gironde absorbe la filiale française de Texas Cy et devient concessionnaire de la marque Texaco.
1935
En s’unissant aux Établissements André et fils, la Standard Oil of New Jersey devient la Standard française des pétroles.
1936
Les recherches menées en Algérie depuis 1892 connaissent un fort ralentissement pour une vingtaine d’années.
1937
Lancement du pétrolier Émile Miguet (22 000 tonnes), plus grand pétrolier français du moment.
Paul Ramadier, sous-secrétaire d’État aux mines et aux combustibles liquides du gouvernement de Front Populaire relance la prospection pétrolière en France (qui avait donné très peu d’indices concluants). À son initiative est créé le Centre de recherches de pétrole du Midi qui dépend de l’ONCL.
1938
La moitié des importations pétrolières françaises s’effectue sous pavillon français.
La France possède 14 raffineries d’une capacité de 8 millions de tonnes.
1939
L’ONCL est remplacé par la Direction des carburants.
À la suite de la découverte du gisement de gaz de Saint-Marcet le 14 juillet 1939 (près de Saint-Gaudens)[b]C'est le même champ que celui de Lacq, même s'il est assez loin [/b]par le CRPM, création de la Régie autonome des pétroles (la société compte un peu plus d’une centaine de personnes à sa création).
1940
Expulsion des ingénieurs français qui travaillaient en Roumanie.
Les actifs irakiens de la Compagnie française des pétroles sont mis sous séquestre par les Anglais.
1941
Loi du 18 juillet qui définit le périmètre d’exploration dévolu à la RAP.
La loi du 21 août précise les attributions de la Direction des carburants.
Création à partir de l’arsenal de Tarbes de la société des matériels de forage pour fabriquer le matériel dont l’achat à l’étranger est impossible.
Création le 10 novembre de la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) dont les actionnaires principaux sont l’État et l’Office national industriel de l’azote. Pierre Angot est à la fois président de la SNPA et de la RAP.
1942
Le périmètre d’exploration de la SNPA est défini : il est immense mais sans éléments prometteurs.
La RAP installe une usine de dégazolinage à Peyrouzet avec du matériel CFR.
1943
La capacité de raffinage de la France est tombée à 1,5 million de tonnes ; la consommation est seulement de 300 000 tonnes dont la moitié en essence.
La RAP qui fore un peu dans sa zone doit coexister avec la société allemande Kontinental Öl car les Allemands manquent de pétrole (ils réquisitionnent la production de Gabian).
Les sociétés pétrolières voient leurs effectifs gonfler artificiellement (étudiants se cachant du STO).
Le gaz de Saint-Marcet atteint Saint-Gaudens.
1944
Création de l’Institut français du pétrole (IFP).
Naissance de la Société nationale des pétroles du Languedoc méditerranéen.
Lors du bombardement le 3 août1944 par I’aviation américaine, où 106 forteresses volantes déversèrent plus de 2 000 bombes, la raffinerie de Péchelbronn est détruite à 90 %.
1945
Création du Bureau de recherche des pétroles qui finance et coordonne les recherches de pétrole des différentes sociétés nationales, de la Société nationale des matériels pour la recherche et l’exploitation du pétrole (SN MAREP), de la Société nationale des gaz du sud-ouest (commercialisation du gaz de la RAP et de la SNPA).
1946
Décret du 14 juin 1946 instituant le « statut du mineur ».
Nationalisation du gaz (loi du 8 avril).
Premier rapport de la Commission de modernisation des carburants.
Constitution de la SN REPAL (Recherche et exploitation des pétroles en Algérie), à 50/50 entre le Gouvernement général de l’Algérie et le BRP. Cette société commence l’exploration géologique du Sahara.
La seule production notable en France reste celle de Péchelbronn avec 50 000 tonnes.
Le gaz de la RAP arrive à Pau et St Gaudens.
1947
Les raffineries de pétrole de l’Atlantique reconstruisent la raffinerie de Donges.
Les premiers appareils de forage en provenance des États-Unis arrivent en France.
Les Pétroles Jupiter et la Compagnie des produits chimiques et raffineries de Berre s’associent dans la compagnie de raffinage Shell Berre.
La société des raffineries de pétrole de la Gironde devient filiale du groupe américain California Texas Oil Cy. La marque CALTEX se substitue à la marque Texaco.
1948
Création de la Shell française (Pétroles Jupiter).
Introduction de toute une série de techniques modernes (sismique, boues synthétiques…).
1949
Création de la Société de recherche et d’exploitation des pétroles en Tunisie, de la Société des pétroles d’Afrique équatoriale (SPAEF).
Découverte de pétrole à Lacq (Lacq dit « supérieur »), au cap Bon en Tunisie.
Mise en service du gazoduc de la RAP entre Toulouse et Bordeaux.
Fusion de la Compagnie industrielle des pétroles et de la Vacuum française sous le nom de Socony-Vacuum française.
1950
Création du fond de soutien aux hydrocarbures alimenté par une redevance incluse dans le prix des carburants.
Création de la Société des pétroles de Madagascar.
Inauguration de la raffinerie d’Ambès reconstruite après la guerre.
1951
Création d’Antargaz.
Découverte du gisement de gaz de Lacq le 19 décembre (Lacq profond).
Éruption, forte émotion dans la région car le gaz a une forte teneur en soufre.
La CFP commence à s’intéresser au Canada.
1952
La France possède les deux plus grands pétroliers du monde (31 600 tonnes).
Nombreux permis de recherche demandés au Sahara.
Le pompier volant Myron Kinley vient à bout de l’éruption de Lacq après 53 jours.
Origine de la mise en place du détachement de la BSPP
Mise en service de la raffinerie de Dunkerque.
1953
Loi autorisant les sociétés de pétrole à créer en franchise d’impôts une provision spéciale pour reconstitution de gisement (PRG) sur l’exemple américain.
Création de la Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) dans le capital de laquelle on trouve la Shell.
1954
Découverte par Esso du gisement de Parentis dans les Landes (Esso).
Plusieurs permis pris dans la région parisienne.
Fusion Antar et Raffineries françaises de pétrole de l’Atlantique.
Première éruption de gaz au Sahara (Berga).
La Société générale des huiles de pétrole prend le nom de Société française des pétroles BP.
Apparition de la marque Total.
1955
Création de nombreuses sociétés « REP » (Petrorep, Essorep, Cofirep…) destinées à soutenir la recherche d’hydrocarbures.
Ralentissement de l’exploration en Afrique du Nord vues les circonstances politiques troublées.
Les aciéries de Pompey et la société Vallourec mettent au point des tubes en acier capables de résister à la corrosion par le soufre du gisement de Lacq.
Importance des méthodes géophysiques (sismique réfraction et réflexion, sondage électrique…).
La société des raffineries de pétrole de la Gironde devient CALTEX Petroleum SAF.
Début du déclin de l’exploitation de Péchelbronn.
1956
Nombreuses créations de sociétés dans l’atmosphère d’euphorie qui suit les nombreuses découvertes pétrolières et gazières.
Création de la Compagnie française du méthane qui doit commercialiser le gaz de Lacq (SNPA et GDF).
Découvertes au Sahara d’Edjeleh et d’Hassi Messaoud, de pointe Clairette au Gabon.
1957
Poursuite de la création d’entreprises pétrolières.
Découverte d’Hassi r’Mel (gaz) au Sahara.
Démarrage de l’usine de Lacq.
Première cargaison de pétrole d’Afrique noire française par pétrolier le 20 avril à Port-Gentil (gisements d’Ozouri et de Pointe-Clairette).
1958
Nouvelle découvertes au Sahara : El Gassi, Zarzaïtine…
La SNPA commence à vendre le soufre de Lacq.
Construction du pipe-line d’Hassi Messaoud vers Bougie.
1959
Découverte du gisement de gaz de Groningue aux Pays-Bas et intérêt nouveau pour les possibilités de la mer du Nord.
Mise en service de la raffinerie du bec d’Ambès (Standard française).
Le Bassin parisien produit environ un demi million de tonnes de pétrole.
Les entreprises pétrolières nationales s’autofinancent.
1960
Création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à Bagdad.
La France connaît une véritable euphorie pétrolière et gazière.
Premier regroupement des entreprises nationales sous le nom d’Union générale des pétroles (UGP), essentiellement la RAP, la SN REPAL et les filiales productrices du BRP.
Création de l’UIP (60 % UGP et 40 % Caltex).
Les indépendances africaines ont des conséquences : la SPAEF devient SPAFE (pétroles d’Afrique équatoriale).
Le pétrole brut d’Edjeleh arrive à In Amenas La Skirra.
La nouvelle UGP opte pour des raffineries intérieures comme Grandpuits en région parisienne, Feyzin au sud de Lyon et Gargenville dans la vallée de la Seine.
Construction du complexe pétrochimique de Lacq (grand mouvement de la carbochimie vers la pétrochimie).
1961
L’Irak nationalise la quasi-totalité du domaine minier de l’Irak Petroleum Company.
Premier forage off-shore au Gabon.
Découverte de Gassi Touil au Sahara.
Crise de Bizerte qui bloque pendant deux mois les enlèvements à La Skirra.
1962
Indépendance de l’Algérie mais accords de continuité avec les sociétés françaises.
Le BRP diversifie en conséquence ses recherches vers l’étranger.
Découverte du gisement off-shore d’Anguille au Gabon.
Incendie du puits de Gassi Touil (éteint par Red Adair).
1963
Création de la SONATRACH par le gouvernement algérien (mais l’Algérie reste le premier lieu d’investissements du BRP).
Prise de participation majoritaire de la SNPA dans la société ORGANICO (fabrication du rilsan à partir d’huile de ricin).
Mise en service de la raffinerie de la Compagnie rhénane de raffinage à Reichstett-Vendenheim.
Mise en service de la raffinerie de Strasbourg (Compagnie française des pétroles, Compagnie française de raffinage, Péchelbronn et Antar).
Décrets Leblond qui ramènent les autorisations d’importation de pétrole à 10 ans et donnent une part importante à l’UGP (14,5 %) dans les quotas d’importation, au détriment surtout des grandes sociétés internationales.
1964
Le gouvernement redéfinit les objectifs de la politique pétrolière française (garantie d’indépendance et sécurité des approvisionnements).
Consortium entre la Compagnie française des pétroles et la SNPA pour obtenir des permis en mer du Nord.
Mise en route de Feyzin.
Les produits de l’UGP sont commercialisés sous de nombreuses marques (Caltex, Avia, La Mure…).
1965
Accords de coopération entre la France et l’Algérie (ASCOOP) qui aboutit à la quasi-nationalisation du gaz.
Naissance de l’ERAP (entreprise de recherches et d’activités pétrolières) qui résulte de la fusion BRP et RAP.
Découverte par une filiale de la SNPA d’un gisement de pétrole au Canada.
Fusion Desmarais-Total.
Construction d’un oléoduc entre Le Havre et Nangis pour alimenter la raffinerie d’Ile de France.
Inauguration de la raffinerie de Fos-sur-Mer.
1966
Le Ve Plan préconise le rassemblement des entités pétrolières.
Regroupement des filiales de distribution publiques dans l’UGD.
L’ERAP s’intéresse à l’Iran.
Grave accident à la raffinerie de Feyzin.
Mise en service de la raffinerie de Grandpuits.
La Socony-Vacuum française prend le nom de MOBIL OIL française.
1967
Constitution de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole.
Conflit entre Israël et ses voisins (guerre des Six jours) et guerre civile au Biafra.
L’Union générale de production devient Elf Union, l’Union générale de distribution devient Elf Distribution (24 % Caltex et 76 % Elf Union).
Lancement le 27 avril de la marque Elf (campagne des ronds rouges).
Accord entre l’Algérie et Gaz de France pour la commercialisation de gaz liquéfié transporté par méthaniers.
Construction de la raffinerie de Gargenville (dite du Vexin).
1968
Elf s’intéresse à l’Irak, zone historique de la CFP-Total.
Mise en service de Gargenville.
Découverte du gisement Émeraude au Congo.
1969
L’Algérie rejoint l’OPEP.
Attribution d’un bloc en mer du Nord à l’ERAP sur une structure prometteuse.
Découverte d’Ekofisk en mer du Nord.
Rapprochement entre les branches chimie des deux pétroliers français.
Mise en service de la raffinerie de Vernon.
1970
Renversement de tendance : le pétrole cesse de baisser (prise du pouvoir par le colonel Khadafi en Libye).
Rachat d’Antar par l’ERAP.
Fin de l’activité de raffinage autour du gisement de Péchelbronn.
1971
Nationalisation par l’Algérie des compagnies pétrolières (51 %) et gazières (100 %) opérant sur son territoire. La CFP et Elf-ERAP ne peuvent enlever que 5 millions de tonnes de brut en Algérie. Le coup est dur pour l’ERAP qui s’éloigne de l’Algérie (à la différence de Total) et se donne quatre ans pour retrouver son niveau de production.
Premières hausses du brut (accords de Téhéran).
Découverte du gisement gazier de Frigg, à cheval sur les zones britannique et norvégienne de mer du Nord.
Découverte du gisement de Grondin au Gabon.
1972
Total confirme l’intérêt du champ de Frigg.
La production annuelle de ce champ est estimée au double de celle de Lacq.
1973
Loi du 21 décembre qui autorise le gouvernement français à répartir et contrôler le secteur énergétique.
Guerre du Kippour ; forte hausse du brut décidée par les pays producteurs (quadruplement).
Rapprochement ERAP-SNPA.
Le gisement de Frigg sera exploité et transporté par Elf Norge et Total.
1974
La France n’adhère pas à l’Agence internationale de l’énergie.
Création de l’Agence pour les économies d’énergie.
Rapport Schwartz assez hostile aux compagnies pétrolières.
Affaire des ententes.
Reprise de l’exploration en France.
Nouvelle raison sociale : ESSO société anonyme française.
Livraison des raffineries de Dunkerque et Flessingue.
1975
Nouveaux objectifs gouvernementaux destinés à moins dépendre du pétrole et d’un seul fournisseur.
Elf, Total et la Shell française lancent une grande campagne d’exploration en mer d’Iroise.
Le groupe Elf retrouve son niveau de production d’avant la nationalisation algérienne grâce en particulier aux ressources gabonaises (10 millions de tonnes).
Découverte du gisement d’Alwyn en mer du Nord.
1976
Restructuration profonde du groupe Elf : la SNPA devient Société nationale Elf Aquitaine ; la société Antar distribuera les produits Antar.
Commande de deux pétroliers de 500 000 tonnes (Pierre Guillaumat et Prairial).
Premières têtes de puits sous-marines fonctionnant automatiquement (Grondin au Gabon).
1977
Mise en production de Frigg.
Baptême du Pierre Guillaumat de 554 000 tonnes.
1978
Troubles en Iran et renversement du Shah.
1979
Second choc pétrolier.
Désengagement d’Elf dans l’affaire des avions renifleurs.
CALTEX se retire d’Elf France.
1980
Mise au point d’un robot pour travailler en grandes profondeurs (TIM).
1981
Débuts des recherches en Angola.
1982
Création de l’AFME (Agence française pour la maîtrise de l’énergie) qui remplace l’AEE.
Fermeture de la raffinerie de Valenciennes.
Restructuration de la chimie française.
1983
Le prix du baril baisse sensiblement mais le dollar s’envole.
Création d’ATOCHEM dans le secteur de la chimie (ATO Chimie, CHLOE Chimie et en partie chimie de Péchiney Ugine Kuhlmann).
L’affaire des avions renifleurs éclate dans la presse.
Essais réussis de forages horizontaux.
Fin de la modernisation de la raffinerie de Donges.
1984
Difficultés persistantes dans le domaine du raffinage.
La société Horwell est chargée de commercialiser la technique du forage horizontal.
1985
Les explorations en mer d’Iroise ne donnent pas d’indices sérieux.
La Compagnie française des pétroles devient Total CFP.
Distribution d’essence sans plomb.
1986
Contre-choc pétrolier : le prix du baril est divisé par deux par rapport à l’année précédente (baisse du dollar en parallèle).
Du fait du changement de majorité, début de la privatisation du groupe Elf-Aquitaine.
1987
Le dollar poursuit sa baisse.
Krach boursier en octobre.
Découverte de petits gisements en région parisienne.
1988
Création d’une société anonyme qui prend en charge la moitié du stockage de réserve obligatoire (45 jours) : la SAGESS.
1989
Regroupement des activités hydrocarbures chez Elf-Aquitaine.
Renouvellement du concept des stations-service.
1990
Le renchérissement modeste du prix du baril à cause de la crise du Golfe est atténué par la baisse du dollar.
Création de l’ADEME qui succède à l’AFME.
1991
Le ministère de l’Industrie encourage la recherche d’hydrocarbures dans le sud-est et la région parisienne.
Un Français est nommé à la tête de la Society of Petroleum Engineers (le premier non américain) : Jacques Bosio.
Total CFP devient Total.
L’action Elf-Aquitaine entre au New York Stock Exchange.
1992
Les changements géopolitiques en Europe de l’Est pénalisent les résultats des sociétés pétrolières (ainsi que les désordres monétaires).
La loi du 31 décembre 1992 met fin en grande partie au régime pétrolier instauré par la loi de 1928.
Intérêt porté à l’exploration dans le Kazakhstan.
L’État qui possédait depuis 1931 35 % du capital de la CFP-Total se désengage une première fois.
1993
Deuxième vague de privatisation du fait de l’alternance politique (décret du 21 juillet 1993).
1994
Privatisation d’Elf-Aquitaine.
1996
Poursuite du désengagement de l’État dans le capital de Total.
L’État ne conserve qu’une golden share dans le capital d’Elf.
1997
Amorce d’un mouvement général de concentration dans le secteur pétrolier mondial (« mégafusions »).
1998
Dernière étape du retrait de l’État du capital de la société Total.
Total se rapproche amicalement de Petrofina.
1999
Les conseils d’administration de Total Fina et d’Elf Aquitaine proposent à leurs actionnaires de rapprocher les deux entreprises de façon amicale.
2000
La commission de l’Union européenne approuve le rapprochement des deux sociétés pétrolières françaises.
Total Fina Elf détient 99,5 % d’Elf-Aquitaine à l’issue de l’offre publique de retrait sur les titres Elf Aquitaine lancée en France et en Amérique du Nord. |
source CNRS
briga |
|
|
  |
 |
Brachou
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 120
Localisation: 64

|
 Posté le:
24 Nov 2008, 19:01 Posté le:
24 Nov 2008, 19:01 |
  |
Merci Briga!
à artix en 1999 2003 je dois peut être t'avoir en photos sur un des calendriers!  |
|
|
  |
 |
|
|
|